Pourquoi, diable, pourquoi, tout le monde crie au génie à l’évocation de The Kills ? Quelqu’un pourrait-il m’expliquer ? Non, sérieusement parce que je n’arrive pas à comprendre. Certes je leur trouve quelques qualités à ce duo, une chanteuse classe, un son garage rock que j’affectionne, un certain charme lo-fi. Mais, pour une raison que j’ignore la sauce ne prend pas vraiment avec moi. Je ne saisi pas « le truc ». Je trouve la boîte à rythme vraiment trop « cheap » et cela leur donne un côté par trop monolithique pour mon goût personnel. Il n’y a guère que sur le dernier titre, joué en duo à deux guitares que le groupe retrouve un peu de la magie du Velvet Underground mais à part ça… Je les avais déjà vu il y a quelques années au festival des Inrockuptibles et je n’en garde pas un souvenir impérissable. Et ce n’est pas leur prestation de ce soir qui risque de me réconcilier avec eux mais bon puisque tous les goûts sont dans la nature…
Et on termine enfin avec la grosse affaire de la soirée le set de Gossip (voir mon message du 24 septembre 2007). Depuis le début des années 90, Gossip végétait dans une sorte de garage rock sympa, certes, mais assez anecdotique. L’arrivée de la nouvelle batteuse Hannah a complètement changé la donne, Gossip ne boxe plus dans la même catégorie. Quelle est la grande qualité d’un batteur ? Cette faculté de se mettre au service des chansons. La batterie n’est pas un instrument mélodique, bien savoir s’en servir, c’est savoir soutenir les autres musiciens sans tirer la couverture à soi. Et c’est exactement ce que fait Hannah, la batteuse de Gossip. Son jeu n’a rien de superflu, de spectaculaire ni de technique. Mais c’est exactement ce dont a besoin ce groupe. Dans ce contexte, elle est super efficace, booste les deux autres. Ca colle parfaitement et c’est ce que j’adore chez elle. Depuis ce changement, Gossip a littéralement explosé. Beth Ditto, l’incroyable chanteuse, lesbienne assumée et revendiquée est depuis devenu une icône gay. Elle aussi est impressionnante, malgré sa corpulence, 1m60 et une centaine de kilos, elle saute dans tous les sens. Et puis il y a cette voix… Pourtant, j’ai quand même été un peu déçu par le trio, accompagné ce soir par un renfort bassiste sur certains morceaux, qui, à mon avis, n’a pas joué la setlist que son immense talent mérite, piochant beaucoup trop dans son vieux répertoire. Il y a eu quand même de longs moments de flottement. Bon je dis ça mais en même temps je fais la fine bouche, « Yr mangled heart » et « Jealousy » sont rageurs. « Coal to diamonds » apporte une touche plus émotionnelle, qu’à mon avis ils devraient explorer plus avant. Et puis ils ont fini par retourner complètement la salle avec un « listen up » explosif. La scène est alors envahie par le public et transformée en dancefloor, la sécurité est complètement débordée. Et il y eu enfin ce « Standing in the way of control », joué en rappel, d’anthologie électrique. Le public est alors complètement survolté. Beth est alors revenue seule sur scène pour entonner l’air de « la vie en rose », il est vrai que l’on est à l’Olympia, histoire de calmer un peu l’audience… Encore une belle soirée malgré tout, et un réveil difficile ce matin et des tasses de café noir pour se réveiller…
Gossip : Listen Up (live big weekend 2007) :
Gossip : Standing in the way of control (live eurockéenes 2006)










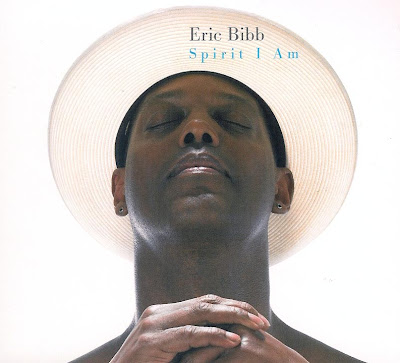







 Situé dans le huitième arrondissement, le Showcase est une salle chic et classe, une des plus belles de la capitale. Dès la sortie du métro on est en pleine carte postale, l’hôtel des Invalides, le Grand Palais, la Tour Eiffel qui à la nuit tombée scintille de mille feux et le pont Alexandre III, sous lequel se trouve le Showcase. En effet, le Showcase est située sous le pont, sur les quais. La salle est toute en longueur séparée en deux par des arcades. Les murs sont en pierre blanche. A gauche des arcades se trouve le bar, un espace lounge agrémenté de tables basses, de fauteuils et de canapés noirs et d’un baby-foot. La vue sur la Seine est époustouflante (pendant le concert, les lumières des bateaux mouches, se reflètent sur les murs) grâce à l’immense baie vitrée, décorée avec de lourds rideaux en velours rouge/bordeaux. A droite des arcades, on trouve la salle de concert à proprement parler, la scène et une fosse, de forme rectangulaire, un peu comme un grand couloir. Comme vous pouvez le voir, pour leur retour sur une scène française, les Nada Surf ont de la chance de pouvoir jouer dans un endroit aussi beau. En fait le problème du Showcase, c’est surtout l’état d’esprit qui y règne. Situé dans les beaux quartiers, l’endroit est majoritairement fréquenté par une clientèle plus bourgeoise que bohème. Le week-end, l’endroit devient une boite de nuit tendance bobo/chic dans laquelle il n’est pas aisé de rentrer, physionomiste à l’appui. Mais ce soir il s’agit d’un concert donc on devrait pouvoir éviter ces désagréments, même si quelques spécimens bobo sont tout de même présents, on se demande bien pourquoi (ils n’en ont rien à battre du groupe) ?
Situé dans le huitième arrondissement, le Showcase est une salle chic et classe, une des plus belles de la capitale. Dès la sortie du métro on est en pleine carte postale, l’hôtel des Invalides, le Grand Palais, la Tour Eiffel qui à la nuit tombée scintille de mille feux et le pont Alexandre III, sous lequel se trouve le Showcase. En effet, le Showcase est située sous le pont, sur les quais. La salle est toute en longueur séparée en deux par des arcades. Les murs sont en pierre blanche. A gauche des arcades se trouve le bar, un espace lounge agrémenté de tables basses, de fauteuils et de canapés noirs et d’un baby-foot. La vue sur la Seine est époustouflante (pendant le concert, les lumières des bateaux mouches, se reflètent sur les murs) grâce à l’immense baie vitrée, décorée avec de lourds rideaux en velours rouge/bordeaux. A droite des arcades, on trouve la salle de concert à proprement parler, la scène et une fosse, de forme rectangulaire, un peu comme un grand couloir. Comme vous pouvez le voir, pour leur retour sur une scène française, les Nada Surf ont de la chance de pouvoir jouer dans un endroit aussi beau. En fait le problème du Showcase, c’est surtout l’état d’esprit qui y règne. Situé dans les beaux quartiers, l’endroit est majoritairement fréquenté par une clientèle plus bourgeoise que bohème. Le week-end, l’endroit devient une boite de nuit tendance bobo/chic dans laquelle il n’est pas aisé de rentrer, physionomiste à l’appui. Mais ce soir il s’agit d’un concert donc on devrait pouvoir éviter ces désagréments, même si quelques spécimens bobo sont tout de même présents, on se demande bien pourquoi (ils n’en ont rien à battre du groupe) ?





























